Si l’on se préoccupe aujourd’hui de la qualité de l’eau courante, c’est parce qu’elle est présente dans tous les logements : il suffit d’ouvrir le robinet. Un simple geste devenu aussi banal que le maniement d’un interrupteur électrique. Pourtant, il y a un siècle – autant dire hier –, à Paris, ce geste était loin d’être banal.
Limpide et claire, telle était l’eau de la Seine à Lutèce. L’empereur Julien affirmait qu’elle était très agréable à boire ; en outre, de nombreuses sources ruisselaient des collines. Toutefois, pour alimenter les thermes de la rive gauche, les Romains recherchèrent une concentration plus importante. Ils la découvrirent sur le plateau de Wissous et l’acheminèrent vers Lutèce par un aqueduc de seize kilomètres longeant la vallée de la Bièvre qu’il franchissait à Arcueil, pour aboutir à Montsouris.
Des siècles de pollution
Après les invasions barbares, les ouvrages romains tombent en ruine. Les Parisiens puisent l’eau de la Seine et creusent des puits. La nappe phréatique est riche, mais si elle est proche de la surface de la rive droite, rive gauche il faut parfois creuser jusqu’à trente mètres. A l’abri derrière ses enceintes successives, la cité se densifie ; on creuse toujours plus de puits et la corporation des porteurs d’eau se développe.
Mais le temps passe et l’eau du fleuve et des puits devient de moins en moins limpide. Lors de la terrible épidémie de peste noire de 1348-1349, on constate que la contagion fait rage intra-muros ; et que parmi les communautés religieuses établies hors les murs, il y a peu de victimes. Le fleuve et la nappe aquifère sont pollués et cette pollution remonte dans les puits. Constat inquiétant mais qui semble ne pas prêter à conséquences. Boileau décrira la repoussante saleté des rues au XVIIe siècle. Mais les odeurs n’incommodent guère les Parisiens, ils n’ont ni le nez ni les intestins sensibles. Ce n’est pas le cas des visiteurs étrangers. Sous Louis XV, le chevalier de Mannlich écrit dans des Mémoires : « […] la Seine, toute sale qu’elle est, abreuve néanmoins les habitants de cette capitale. Pour la rendre potable il faut la clarifier, et quand on pense que tous les jours on retire de cette rivière des cadavres, de la charogne, et que les fosses d’aisance de la ville s’y déversent, sans parler des autres immondices qu’on y jette, on n’est guère tenté de se désaltérer avec une boisson chargée de tant de matières dégoûtantes. Il n’y a seulement que les étrangers qui éprouvent cette répugnance ; pour le Parisien, il est d’avis que, sous ce rapport, il habite une des villes de France les plus favorisées. »
Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que l’on commence à se poser des questions, avec les prémices de l’analyse chimique. On déplore l’habitude d’utiliser l’eau des puits, tous pollués, alors qu’apparaît une distinction entre l’eau alimentaire et celle des nettoyages.
Une situation très complexe

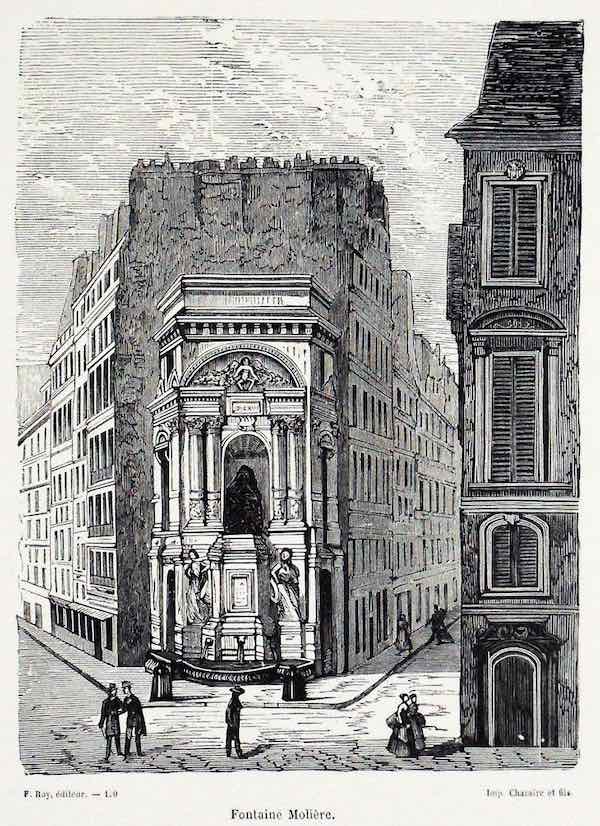
Si les financiers étaient prêts à investir dans de vastes travaux, les propriétaires d’immeubles, les vidangeurs et les porteurs d’eau freinaient des quatre fers, les premiers parce qu’ils allaient y perdre de l’argent et les autres leur métier. Quant aux besoins, ils souffraient d’évaluations approximatives : 20 litres par jour et par habitant en 1760, 70 en 1817, 100 en 1846, 500 en 1850… ! Photo : Fontaine Molière au XIXe siècle, janvier 1890, F. Roy éditeur, Charaire et Fils imprimeur, @WikiMediaCommons.
Or, la situation ne pouvait qu’empirer. L’épidémie de choléra de 1832 avait fait réfléchir sur l’insalubrité des logements, le manque d’égouts, l’eau des puits. Pour donner une idée des risques côtoyés quotidiennement, indiquons qu’avant le drainage de 1862, la fosse commune du Père Lachaise se remplissait chaque nuit d’une eau chargée de matières grasses, provenant des marnes vertes de la nappe aquifère, et qu’il fallait chaque matin épuiser pour poursuivre les inhumations. Ce constat est de l’ingénieur Belgrand, qui notait que la nappe et tous les puits alentour étaient contaminés par le célèbre cimetière.
Haussmann et Belgrand
La révolution qui devait conduire à l’eau courante éclata en 1850 avec la loi relative à l’assainissement des logements insalubres, suivie d’une ordonnance de police sur les fosses d’aisances. Les grands travaux commencèrent en 1853. Il faut savoir gré à Napoléon III d’avoir nommé Haussmann préfet en lui laissant carte blanche, et à Haussmann d’avoir choisi l’ingénieur Eugène Belgrand. Ces trois hommes, chacun à leur place, partagent une même vision prospective. Haussmann sait qu’il faut opérer Paris au cœur, moins pour éviter les barricades qu’une asphyxie certaine. Belgrand réalise que le principe du réseau est la seule solution réaliste, plus complexe et plus coûteuse, mais la plus satisfaisante à long terme.

Les eaux de la Dhuis (Aisne) vont aboutir au réservoir de Ménilmontant. Celles de la Vanne (Yonne), du Loing et du Lunain (Seine et Marne) vont se déverser dans le réservoir de Montsouris, avec celles de la Voulzie (Haute Marne) qui rejoignent leur aqueduc (73 kilomètres) en forêt de Fontainebleau. Les eaux de l’Avre (Eure) seront menées par un aqueduc de 120 kilomètres (achevé en 1893) au réservoir de Saint-Cloud. Celui de Montsouris sera la dernière œuvre de Belgrand qui s’éteint en 1878 : un « palais des eaux tranquilles » construit sur d’anciennes carrières, où 1 800 piliers soutiennent, sur deux niveaux, la couverture de brique et de terre gazonnée qui maintient l’eau captive et pure à une température constante de 10 °C. Photo : Edouard Baldus, Puits Artésien (N°39), Getty Museum, papier albumine, 29,5 x 18,5 cm, @WikiMediaCommons.
Belgrand avait vu grand mais juste. Il préconisa la double canalisation, édifiant deux réseaux distincts : un pour l’eau alimentaire, un pour les autres usages (voirie, industries) alimenté par les eaux de la Seine et de la Marne, collectif et… gratuit ! Dans le même temps, il dotait la capitale d’un réseau d’égouts digne d’elle (à sa mort, plus de 600 kilomètres avaient été creusés), mais cela est une autre histoire.
Une affaire en or
Les choix d’Haussmann et de Belgrand, s’ils furent mal reçus par les propriétaires, considérant que le gouvernement les guillotinaient « à la hauteur des poches », le furent fort bien par les financiers et les entrepreneurs. Fondés en 1853, la CGE (Compagnie Générale des Eaux) rassemble les barons de la finance : Rothschild, Fould, Pereire, Laffitte, convaincus que la distribution des eaux va prendre la suite des chemins de fer. Les actions de la compagnie ne sont donc pas difficiles à placer. La première opération de la CGE fut lyonnaise, avec la concession, à des conditions juteuses, des services publics de distribution de la capitale des Gaules. La seconde fut nantaise, mais ce n’étaient que des hors-d’œuvre ; le plat de résistance, Paris, fut obtenu en 1860. Le contrat répartissait clairement les rôles : à la Ville les infrastructures et leur entretien (financés par l’impôt), à la CGE la distribution commerciale. Paris fournit le contenant et la CGE vend le contenu aux Parisiens.

– les filtres clarifiants : pierres poreuses en grès + sable et/ou graviers + masse de laine dégraissée,
– les filtres purifiants à base de charbon pulvérisé. Le filtre de Pierbourg combinait ces deux méthodes, en y ajoutant une éponge pour arrêter les particules de sable. Photo : Grands bassins du réservoir de Montsouris, Paris XIVe. @WikiMediaCommons.
Avec la pollution des puits, les particuliers n’étaient pas en reste. En 1829, dans son Manuel d’économie domestique, madame Celnart livre son procédé pour purifier l’eau : prendre un pot de fleurs vide, le garnir d’un fond d’osier, puis d’une couche de charbon recouverte d’un lit de sable. Ce procédé est très proche du filtre de Pierbourg et les filtres de table de Buhring, en vente vers 1845, ne comportent qu’un bloc de charbon poreux immergé dans l’eau et un siphon.
Cette méfiance envers l’eau délivrée perdura. Vers 1900, elle devint plus technique avec l’utilisation de l’ozone. Plus sophistiqué encore, l’hôtel particulier du collectionneur Moïse de Camondo (construit en 1912) était équipé de stérilisateurs à ultraviolets. Equipement exceptionnel, mais qu’il faut mentionner. Pour les méthodes communes, prenons l’ouvrage de Georges Brunel, La Science appliquée (1912). On y découvre la méthode préconisée par monsieur Girard, chef du laboratoire de la Ville de Paris : mettre une petite quantité de permanganate de chaux, attendre qu’elle agisse (il se forme un dépôt au fond du récipient et la coloration rose de l’eau disparaît), puis décanter.
C’était hier !
L’eau à tous les étages, ce fut comme le gaz : très progressif. Selon une enquête menée en 1892, seulement 290 villes de plus de 5 000 habitants sur 691 distribuaient de l’eau sous pression. Par rapport à la situation de 1850, c’était cependant un progrès énorme. Jusqu’en 1900, l’eau n’est pas systématiquement installée à domicile et peu d’immeubles sont raccordés au réseau. La petite plaque émaillée « Eau courante à tous les étages », avait sa raison d’être. Même au cours de l’entre-deux-guerres, dans le vieux Paris ou certains quartiers populaires, les habitants de nombre d’immeubles allaient, comme à la campagne, chercher leur eau à la fontaine du quartier. On comprend que, même gratuite, on en était économe ! Cela, c’était hier, disons avant-hier pour être plus précis ; ne l’oublions pas en manœuvrant la poignée du mitigeur.



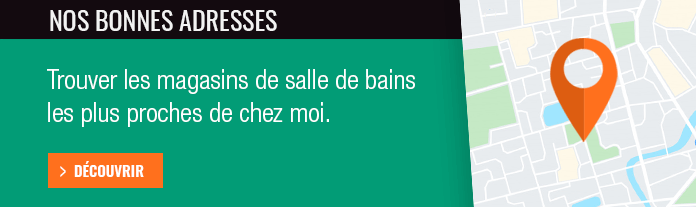




Bravo, magnifique article historique sur un sujet intéressant !
Article très intéressant. Que de stations de métro dans ces noms glorieux ! :-)