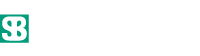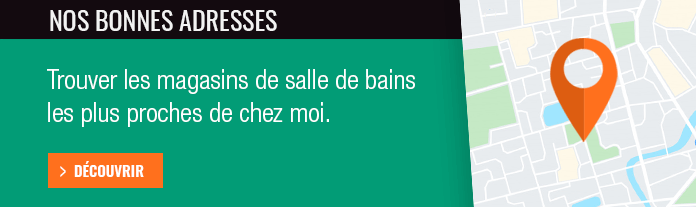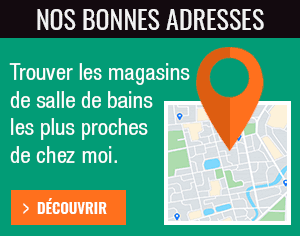L’étymologie réserve parfois des surprises… Savez-vous que le mot lavabo n’a pas toujours eu le sens qu’on lui connaît aujourd’hui ? Avant d’être une pièce maîtresse de la salle de bains, il fut communément associé à une oraison chrétienne. Voici son histoire, du religieux au profane, de la purification de l’âme à celle du corps.

Dans la liturgie catholique, le lavabo fut d’abord une prière. Celle que prononce le prêtre lorsqu’il se rince les doigts avant que le pain et le vin destinés à être bénis ne soient disposés sur l’autel pour l’eucharistie, le rite qui commémore la Cène et célèbre symboliquement le sacrifice du corps et du sang de Jésus Christ : « Je laverai mes mains parmi les innocents, et je me tiendrai autour de votre Autel, Seigneur » [1]. En latin, le verbe laver (lavare), conjugué au futur (lavabo) dans ce verset, évoque la purification de l’âme. Si le geste accompli n’a pas changé, la prière dite du lavabo a évolué à compter des années 1970. Depuis le concile de Vatican II, sa formulation est devenue « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché » [2].
A noter : par métonymie, le mot lavabo désigne aussi le linge liturgique (dit aussi manuterge) qui permet à l’officiant de s’essuyer les mains à ce moment de la messe.
Photo d’ouverture : lavabo de la sacristie du duomo de Carrare, XVIIe siècle, Italie (Wikimedia Commons) ; lavabo du cloître de l’abbaye cistercienne de Poblet, XIIe siècle, Espagne (Wikimedia Commons) ; lavabo, Bourgogne, XIIIe siècle, France (MET museum).
Un glissement, du symbolique au physique

Une multitude de formes pour une fonction pas tout à fait unique

A l’intérieur des édifices religieux, près du chœur, dans la sacristie…, un type de lavabo s’est développé pour accompagner le rite de la prière du même nom, souvent percé dans le fond d’un micro-orifice assurant l’évacuation vers le sol, à défaut de canalisation. Appelées également piscina, certains modèles présentent un plus petit bassin simplement meulé dans la pierre, de façon fruste ; ou sont nichés dans une installation plus complexe sous arche(s), notamment à la période gothique. On les retrouve aussi installés en angle et suspendus, surmontés ou non d’un réservoir, leur cuve en forme de coquille, à l’instar de nombreux bénitiers. Avançant dans le temps, les versions posées sur un jambage, façon console, apparaissent. Sculptés dans le marbre, modelés dans la céramique et vernissés…, les plus somptueux de ces lavabos sont de véritables œuvres d’art…
De « dire » le lavabo à y « faire » sa toilette

Photo ci-dessus : lavabo de la sacristie de l’église de la Santissima Annunziata à Pontremoli, XVe siècle, Italie (Wikimedia Commons) ; lavabo de la sacristie de l’église de Recoaro Terme, Italie (Wikimedia Commons) ; lavabo de la sacristie de San Gaetano, vers 1611, Florence, Italie (Wikimedia Commons) ; lavabo de la sacristie de San Marco, vers 1500-1525 Florence, Italie (Wikimedia Commons).
[1] Traduction du verset 6 du psaume 25 de la Bible : Lavabo inter innocentes manus meas, et circumdabo altare tuum, Domine.
[2] Psaume 50, verset 4.